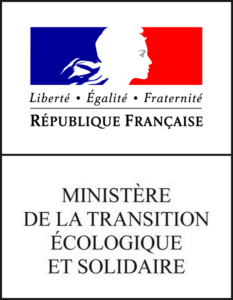Le lac d’Annecy
Sur le lac d’Annecy, les ressources en poissons sont suffisantes pour que deux pêcheurs professionnels les exploitent. Au Bourget, il a fallu adapter temporairement la maille des filets à la taille de poissons, nombreux, mais qui peinent à grossir. Les pêcheurs professionnels du Léman, eux, sont dans l’expectative. Tour d’horizon lacustre.
« Ici, sur le lac d’Annecy, tout va plutôt bien depuis quelques années. Les populations de corégones sont abondantes. Elles se reproduisent naturellement, sans besoin de faire appel à l’alevinage. Mais ce n’était pas le cas, il y a une quinzaine d’années. Les stocks étaient alors au plus bas. On pêche aussi un peu de perches, des écrevisses, truites et ombles chevaliers de temps à autre. » indique Florent Capretti, l’un des deux pêcheurs professionnels du lac.
Sur le Bourget, les poissons ne grossissent désespérément pas. Ils sont toutefois en nombre. L’administration a accepté de baisser temporairement les tailles de captures tout en fixant des quotas de pêche pour permettre aux pêcheurs professionnels de poursuivre leur activité.
« La situation générale du Léman est catastrophique. » se désole Michaël Dumaz, pêcheur sur le Léman et président de l’association des pêcheurs professionnels des lacs alpins. Féras et perches ont quasi disparu des eaux. « Certaines années, il pouvait ne pas y avoir beaucoup de poissons, mais il y avait toujours quelque chose » complète Serge Carraud, pêcheur professionnel sur le Léman « depuis 44 ans ».
« Nos suivis sur les perches sont moins détaillés que sur le corégone par exemple. Nous avons constaté une baisse des statistiques de pêche de la perche en 2024, une baisse des statistiques de pêche de la perche en 2024. Ceci concorde également avec un faible nombre de rubans récoltés, ces cordons formés par les œufs juste après la ponte. Mais nous avons également observé que les reproductions se faisaient plus en profondeur. Nous avons installé une frayère supplémentaire à une profondeur de 20 mètres. Mais cette espèce peut connaître de fortes fluctuations d’abondance. Pour les autres salmonidés (ombles et truites), les niveaux de statistiques restent stables, à des niveaux plutôt bas depuis 2018. Une légère hausse des statistiques pour la lotte est constatée en 2023 » détaille Chloé Goulon, ingénieur d’études indicateur halieutique et ichtyologique, au Carrtel, une unité de recherche de l’Institut national de la recherche en agriculture, alimentation et environnement (Inrae) de Thonon-les-Bains.
Photos ©Carrtel extraites de Réhabilitation des salmonidés des lacs péri-alpins : pacage lacustre
Chamboulements
« Les eaux du lac ne se retournent plus. L’hiver, les températures de l’air sont trop élevées pour suffisamment refroidir les eaux de surface. Les eaux froides sont plus lourdes que les eaux chaudes. En s’enfonçant, elles assurent un brassage qui permet aux nutriments de remonter. L’hiver dernier, le brassage n’a été que partiel, ne s’est fait que sur 110 mètres de profondeur. On espérait un brassage sur des hauteurs d’eau de 180 à 190 mètres. Le froid, avec notamment des épisodes de bise, mais plus courts qu’avant, qui contribuent au refroidissement des eaux, avait été modéré mais plus intense que les années précédentes. » explique Michaël Dumaz.
« Nous avons profité des pêches dites « exceptionnelles » de féras, des pêches de géniteurs pour alimenter les piscicultures d’élevage (cf encadré sur la pisciculture de Rives), pour analyser la qualité de leurs ovocytes. Sur l’échantillon analysé, seuls 30 % d’entre eux étaient fécondables. Nous n’en sommes qu’au début de nos travaux pour comprendre ces problèmes de fécondité. Mais la hausse des températures des eaux n’y est pas étrangère. Une donnée qui pourrait se combiner à la présence de polluants, à la génétique même des populations… » précise Chloé Goulon.
Perturbateurs
La moule quagga et le gammare du Danube, une crevette exotique, deux espèces exogènes, jouent, elles aussi, leur rôle de perturbatrices des équilibres écosystémiques lémaniques. La première, uniformément tapie au fond du lac sur 10 à 15 centimètres d’épaisseur, filtreuse invétérée de plancton, « accentue le manque de ressources alimentaires » indique Chloé Goulon. Le second boulotte à gogo les œufs de féras à même les frayères. « Ils occupaient auparavant une niche écologique bien spécifique et étaient largement consommés par les perches. Mais aujourd’hui ils nichent partout, dans les amas de coquilles, et la chute des populations de perches leur a permis de proliférer » explique Michaël Dumaz. « Des traces d’ADN de moule quagga ont été mises en évidence dans le lac d’Annecy, mais aucun spécimen n’a encore été aperçu » indique Florent Capretti.
Expectatives
« Le Léman est aujourd’hui clairement engagé dans une phase de transition, de changement. » affirme Nicole Galinna, secrétaire générale de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (Cipel). (Lire l’interview de Nicole Galinna).
Lacs communicants
Le manque de poissons, au Léman et au Bourget – la situation sur les lacs alpins suisses et allemands n’est guère différente – détourne les pêcheurs de loisir vers le lac Annecy. On en compte actuellement quelque 1 500 qui pêchent depuis leur bateau. « La pêche amateur voudrait nous imposer, à nous professionnels, nous sommes deux sur le lac, je le rappelle, des quotas de captures. L’administration nous soutient et s’y refuse. Nos quantités de captures sont, de toute façon, déjà contraintes par la réglementation sur les engins qui n’autorise l’utilisation, par jour, que de deux pics et de quatre filets de fond quand ils sont couplés, cinq quand ils ne le sont pas, qu’il y ait du poisson ou pas. Une pression de pêche, définie par les scientifiques, qui est donc toujours la même. » explique Florent Capretti.
Une Cipel qui évoque, en guise de remède à au moins un déséquilibre, la possibilité de « recharger » les eaux du Léman en phosphore, source de nutriments. L’introduction de la souche de corégone du Bourget, mieux adaptée aux changements climatiques que celle du Léman, a également été avancée. Non sans réticences, voire opposition définitive côté suisse, sur les risques d’éventuelles perturbations collatérales de telles introductions d’espèces exogènes. Les scientifiques vont cependant initier des projets sur cette thématique. Enfin, concernant l’avenir des poissons du Léman, Chloé Goulon conclut : « Il y aura toujours du poisson dans le Léman. Mais peut-être plus majoritairement les espèces qui le peuplent aujourd’hui ».
Du prélèvement des œufs à la production d’alevins à la pisciculture de Rives (photos ©Carrtel)
La pisciculture de Rives en question
Dans les années 1980, les scientifiques de la station de Thonon-les-Bains de l’Inra constataient que la chute des populations de salmonidés, ombles chevaliers et corégones, du Léman était liée aux difficultés de reproduction, mais que les conditions naturelles du milieu étaient toujours très favorables à la survie et à la croissance des juvéniles. Leurs recherches aboutissaient à l’amélioration de la reproduction en milieu artificiel et ils transféraient leur savoir-faire à la pisciculture de Rives à Thonon-les-Bains, antique établissement créé au tout début du 19e siècle pour aleviner les lacs alpins. « L’État s’en est dégagé financièrement depuis une vingtaine d’années. Des travaux de rénovation et de modernisation, notamment sur la canalisation de pompage, sont nécessaires. Il faut mettre environ 3 millions d’euros sur la table. Le projet de remise en état était sur les rails. La préfète de Haute-Savoie le défendait. Mais elle est décédée brutalement et le dossier est un peu tombé dans les oubliettes » raconte Michaël Dumaz.
En septembre 2024, l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) publiaient leur rapport d’enquête sur l’état et la pérennité des piscicultures de repeuplement d’espèces en mauvais état de conservation. « Pour la pisciculture de Rives, la mission préconise un désengagement progressif de l’État et un transfert au Conseil départemental de la Haute-Savoie, si celui-ci confirme son intérêt pour l’avenir de la structure, associé à une renégociation des conditions de partenariat avec les interlocuteurs suisses. Cette évolution doit permettre de redéfinir les objectifs assignés à cette pisciculture, y compris le maintien d’un outil et de compétences dans une logique de type assurantiel, en définissant les espèces cibles, les quantités à produire et in fine le modèle économique associé. » peut-on lire. « Dans les années 2010, plus de 60 % des populations d’ombles chevaliers provenaient de l’alevinage. C’était moins notable, sur la base d’une estimation de la littérature, pour les corégones dont la reproduction en milieu naturel était encore importante. Mais, à l’époque, l’alevinage s’est poursuivi afin de maintenir ce savoir-faire de la reproduction en pisciculture » indique Chloé Goulon.